Interview croisée - généraliste/dermato-chirurgien
Quand généralistes et spécialistes confrontent leurs approches
Face à la délicate question des arrêts de travail, généralistes et spécialistes jouent des rôles complémentaires mais parfois divergents. Dans cette interview croisée, la Dre Patricia Halfon, spécialiste en médecine interne générale, et le Dr Andreas M. Skaria, dermatologue FMH et chirurgien de Mohs, partagent leurs perspectives. Comment concilier pragmatisme, approche globale et attentes des patient·es pour assurer une prise en charge adaptée et cohérente?
Propos recueillis par Emilie Berger et Svenn Moretti
Comment évaluez-vous la durée nécessaire d’un arrêt de travail suite à une intervention chirurgicale?
Dr Andreas M. Skaria (AS): Je reçois des patient·es pour des interventions ambulatoires sur des tumeurs cutanées, principalement des reconstructions faciales complexes. La plupart d’entre eux/elles sont retraité·es, donc rarement concerné·es par un arrêt de travail. Pour les personnes actives, seuls quelques cas nécessitent un arrêt court d’un ou deux jours, voire une semaine. Comme spécialiste, j’ai une approche pragmatique et des critères assez clairs pour établir un arrêt de travail. Mentionnons le type de profession (représentation, travaux manuels, exposition à l’humidité), la localisation de la lésion, l’envergure de l’intervention et l’état psychologique du ou de la patient·e. Par exemple, une chirurgie faciale peut justifier un arrêt pour un·e employé·e d’accueil, mais pas pour un·e artisan. Enfin, la perception de la douleur reste individuelle, et le dialogue permet souvent de distinguer un besoin réel d’une demande exagérée.
Dre Patricia Halfon (PH): Le plus souvent, nos connaissances médicales et le sens clinique suffisent à apprécier les limitations et la capacité de travail d’un·e patient·e. S’agissant d’interventions simples, la durée d’incapacité est généralement standardisée et prescrite par le chirurgien. Il arrive que le/la généraliste soit sollicité·e, notamment dans le cas de complications ou de plaintes persistantes et a priori disproportionnées. Cela nécessite d’adopter une approche globale pour cerner quels sont les freins, qu’ils soient physiques, psychologiques ou professionnels (modèle bio-psycho-social). L’intervention du médecin généraliste, qui connaît l’historique de la personne et son environnement, est ici essentielle pour proposer une prise en charge individualisée.
Comment se coordonnent les médecins généraliste et spécialiste concernant les arrêts de travail d’un·e même patient·e?
PH: Globalement, généralistes et spécialistes s’accordent plutôt bien, surtout pour une pathologie avérée et importante. Des situations plus délicates contraignent parfois le médecin à jongler entre deux rôles : celui de soignant, attentif à son ou sa patient·e, et celui d’expert l’encourageant à reprendre le travail. Cette dualité est à la base de divergences entre généralistes et spécialistes, surtout quand un·e patient·e approche l’un des deux parce que l’autre lui a refusé un arrêt. D’où l’importance d’un moment d’échange entre professionnel·les pour proposer un accompagnement respectueux des besoins du ou de la patient·e et des impératifs sociétaux.
AS: Généralement, le ou la patient·e m’est adressé·e par son dermatologue, rarement par un généraliste. J’estime que c’est ma responsabilité de le/la suivre jusqu’à l’ablation des fils, mais cela requiert très rarement un arrêt de travail. Pourtant, je constate que les personnes issues de certaines professions ont tendance à exiger des arrêts de travail pour n’importe quel type d’intervention, en particulier dans l’éducation. Malheureusement, ces patients se tournent souvent, malgré mes explications après l’intervention, vers leur médecin traitant qui établit un tel document sans m’en informer. Durant mes 26 ans de pratique à Vevey, aucun généraliste ne m’a contacté pour octroyer un arrêt à une personne que j’avais opérée.
Face aux affections chroniques nécessitant des arrêts répétés, comment se répartissent les rôles entre généraliste et spécialiste?
PH: Avant toute chose, le dépistage précoce des facteurs de risque de chronicité joue un rôle crucial. C’est pourquoi, une approche globale et une bonne coordination sont indispensables pendant tout le parcours de soins. Dans le cas d’une pathologie installée, les arrêts de travail doivent idéalement être prescrits par un seul médecin, le plus souvent le/la généraliste puisqu’il ou elle est souvent l’interlocuteur/interlocutrice principal·e. Par ailleurs, un contact avec le médecin du travail et l’employeur – dans le respect du secret médical – est particulièrement précieux puisqu’il permet d’avoir accès à des informations concrètes sur les conditions de travail et les possibilités d’adaptation. Malheureusement, tout ce travail de coordination reste difficile à valoriser financièrement avec TARMED.
AS: Ce type de situation se présente rarement chez moi, mais cela arrive dans le cas de soins coordonnés avec un·e généraliste. À mon avis, c’est plutôt le ou la spécialiste qui devrait, dans ce cas, décider du moment où le/la patient·e peut ou non retourner au travail. Prenons par exemple un·e patient·e avec un psoriasis entraînant une atteinte articulaire importante; dans ce cas, je m’occuperais de la peau mais l’établissement d’un arrêt relèverait de la compétence du rhumatologue.
Avez-vous déjà dû gérer des situations où votre évaluation et celle de l’autre médecin divergeaient?
AS: Comme je l’ai mentionné, je note que, durant mes 26 ans de pratique à Vevey, aucun·e généraliste ne m’a contacté pour octroyer un arrêt à une personne que j’avais opérée. Au contraire, j’estime qu’il y a probablement eu plusieurs centaines d’arrêts de travail établis contre mon avis. Auquel cas je ne peux rien y faire puisque je me retrouve devant le fait accompli au moment où le/la patient·e revient pour l’ablation des fils. Parfois, il est même surprenant de voir à quel point certain·es patient·es, convaincu·es que leur arrêt de travail est justifié -parce que prescrit par leur généraliste-, n’hésitent pas à l’exprimer ouvertement.
PH: Dans mon cas, cela n’arrive pas vraiment puisque j’adopte une démarche proactive dès que j’identifie une situation potentiellement délicate, basée sur le principe du patient acteur ou de la patiente actrice de sa santé. Celle-ci consiste à fixer des objectifs clairs en lien avec la reprise du travail, de même que définir les rôles et responsabilités des différent·es intervenant·es impliqué·es dans le suivi du/de la patient·e. Cette approche préventive nous permet d’aligner nos perspectives.
Face à un·e patient·e qui insiste pour obtenir un arrêt a priori non justifié, quelle attitude adoptez-vous?
AS: Souvent, il est beaucoup plus facile d’établir un arrêt de travail que d’expliquer au patient ou à la patiente pourquoi on estime que celui-ci n’est pas justifié. Et je constate que nombre d’entre eux sont établis de façon parfois abusive, notamment lorsque des employé·es souhaitent quitter leur poste. Beaucoup de médecins sous-estiment l’impact d’un arrêt, tant sur la santé des patient·es que sur le système économique et social. Par exemple, mon fils travaille dans une chaîne alimentaire où près d’un tiers des employé·es est en arrêt. Cela devrait nous faire réfléchir profondément à notre rôle de médecin et aux conséquences de nos actes. Il y a quelques années, le conseiller national Philippe Nantermod avait soulevé la question des certificats de complaisance, un débat tué dans l’œuf par la profession médicale. La solution reste entre nos mains, car si les assurances sont conscientes de la situation, elles n’ont que deux options: soit résilier le contrat, soit répercuter les frais sur les employeurs et les employé·es en activité.
PH: Je ressens régulièrement de la difficulté à trancher. Lorsqu’un arrêt de travail me semble injustifié, j’en discute avec le ou la patient·e et nous y réfléchissons ensemble, en lien avec son diagnostic et son contexte de vie. Cela est possible dans le cadre d’une relation déjà établie, mais devient plus complexe s’il s’agit d’un premier contact avec une demande pressante. Dans ce cas, j’aborde les conséquences possibles d’un arrêt de travail sur la santé mais aussi l’environnement professionnel. Je propose aussi des solutions alternatives, comme une consultation avec un médecin du travail pour explorer les possibilités d’aménagement de poste ou l’inclusion d’un·e spécialiste. Et lorsque la demande concerne la durée, je prescris un arrêt plus court en proposant de réévaluer la situation régulièrement. En tout dernier recours, j’évoque les modalités de contrôle potentiellement diligentées par l’employeur ou l’assurance. Cette approche attentive et ferme me permet de maintenir une bonne relation médecin-patient·e, tout en préservant l’intégrité de ma décision médicale.
Partagez votre opinion sur cet article !
Propos recueillis par Emilie Berger et Svenn Moretti
DOC #13 - 2025
Dans le même dossier
De médecin traitant à médecin expert
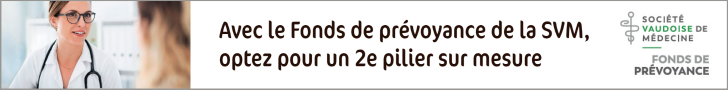

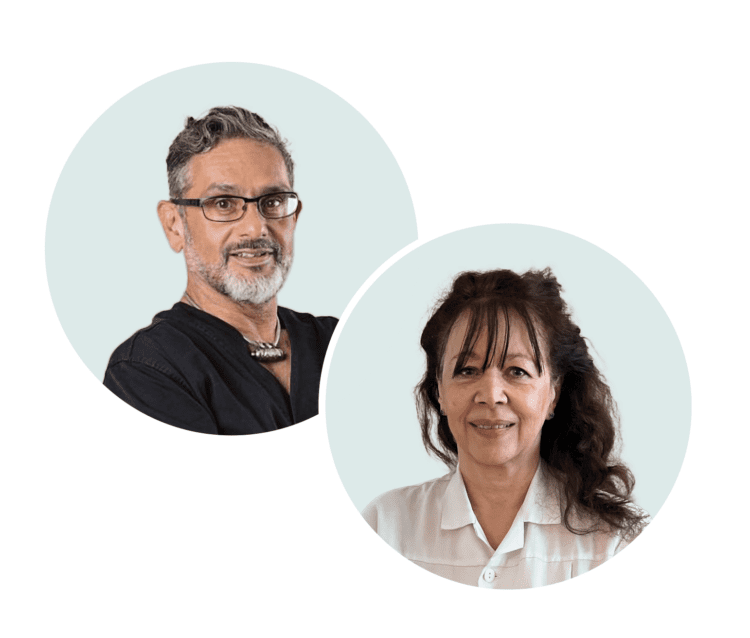
Bonjour,
Parfois c’est l’employeur qui dicte le refus de reprise : » si ce n’est pas à 100%, vous restez en arrêt maladie ».