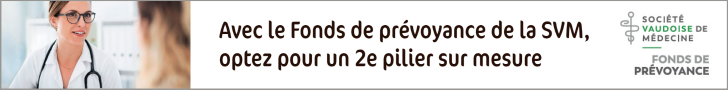En 1999, la SVM était représentée au sein du conseil de la Centrale téléphonique des médecins (ci-après CTMG) qu’elle avait créée, bien avant la fusion au sein de la Fondation urgences santé (FUS). Alors sous la présidence de la Dre Yvette Barbier, j’y ai personnellement siégé pour un temps au début des années 2000 avant de céder ma place à des médecins installé·es.
Dans ce cadre, le conseil examinait prioritairement les incidents signalés et veillait à préserver la mission prioritaire de la CTMG, soit la mise en contact de l’appelant·e avec un médecin de garde, tout en assurant un certain tri préalable, apprécié des médecins.
Numéro centralisé
La SVM percevait des cotisations pour la CTMG (300 francs par an) auprès de ses membres de Lausanne et environs, médecins cadres du CHUV compris. Ceci nous a valu pendant longtemps l’ire de ces derniers au point d’en arriver à une menace de démission en bloc de la SVM, alors sous la présidence du Dr Patrick Ruchat. Résultat : après discussion, les médecins cadres ne démissionnent pas mais leur association intègre la SVM sous la forme d’un groupement constitué et reconnu. De plus, une place leur est offerte au sein du comité de la SVM, occupée par le Dr Lennart Magnusson, suivi d’un certain Dr Philippe Eggimann… La cotisation des médecins pour la garde sera abandonnée au moment de la fusion au sein de la FUS. Elle n’était plus compatible avec l’évolution de cette institution et le rôle laissé à la SVM.
Il existait un service facultatif et payant de télésecrétariat pendant les heures de fermeture du cabinet. Ce service a été abandonné officiellement et sans concertation il y a peu de temps.
La SVM a largement communiqué sur les dispositions du code de déontologie – le sien puis celui de la FMH – qui exige du médecin qu’il ou elle veille à la continuité des soins pendant son absence (organisation collégiale pendant ses absences, informations à ses patient· es, répondeur, etc.)
Au début des années 2000, la SVM a accompagné la promotion auprès des cabinets d’un numéro centralisé (et non pas unique) pour la garde sans pour autant renoncer aux numéros régionaux laissés à l’appréciation des secteurs de garde. Les médecins étaient alors réticents à les abandonner, par crainte d’une saturation de la centrale à certaines périodes (pandémie, épidémie de grippe, etc.). La suite leur a donné en partie raison…
La campagne grand public de l’organe d’information de santé publique de l’Etat de Vaud sanimedia a pris un tour inattendu. Alors que la campagne initiale voulait (déjà) ignorer ou contourner l’importance des cabinets médicaux dans l’information aux patient·es, un sondage de MIS-Trend a renversé l’approche en montrant que 8 Vaudois·es sur 10 consultaient leur médecin traitant au moins une fois par an. La dernière étude commandée par la SVM il y a quelques années et inspirée de la précédente a confirmé cette tendance.
Un premier règlement de la SVM
Au début des années 2000, j’ai participé à l’élaboration du premier règlement de la garde de la SVM sous la présidence des Drs Daniel Laufer et Charles-Abram Favrod-Coune (présidents successifs de la SVM et de la commission de la garde). Certains membres du comité lui-même (encore 2 heures avant la séance…) ne croyaient pas qu’il serait adopté par l’assemblée des délégués, ce qui fût pourtant le cas du premier coup !
J’ai ensuite participé pendant au moins 15 ans à toutes les séances du bureau et de la commission de la garde de la SVM, formée essentiellement des présidents des cercles de garde et dont j’assurais l’organisation et la tenue des procès-verbaux.
« L’exercice de la garde a évolué pour tenir compte des changements de mentalités et de la société. »
En 2005, j’ai négocié personnellement, sous la présidence avisée du Dr Thierry Cuendet, alors président de la commission de la garde, la première convention de la garde médicale, avec le président de la FUS, Henri Corbaz, et le chef du DSAS fraîchement élu, M. Pierre-Yves Maillard. Elle s’est traduite par une contribution à l’organisation de la garde et aux groupements de garde de 200’000 francs par an pendant une quinzaine d’années. Peu de chose au vu des sommes investies dans la nouvelle organisation cantonale de la garde. Surtout, elle préfigurait la convention de partenariat public-privé qui sera conclue quelques années plus tard avec le DSAS, la question de la garde étant emblématique de la médecine.
Réduction et sectorisation
Sous l’impulsion du bureau de la garde et notamment du Dr Pierre Widmer de Nyon, l’exercice de la garde a évolué pour tenir compte des changements de mentalités et de la société : moins de visites à domicile jugées souvent inutiles ou abusives, voire exposées pour le médecin, notamment pour les femmes comme certains exemples l’ont montré (Morges). Aussi pour éviter les accidents ou infractions routières dus à l’urgence ou à la fatigue : un exemple célèbre, dont l’origine est antérieure à mon arrivée à la SVM, nous a valu pas moins de 10 ans de procédure. À Lausanne, nous avons obtenu pour les gardien·nes des macarons de parcage.
Quid de l’avenir ? Sous la présidence du Dr Jean-Pierre Pavillon, président de la SVM et de la garde, cette dernière a évolué avec une réduction et un remodelage des secteurs géographiques. Des tentatives ont été entreprises pour se rapprocher des hôpitaux, avec l’ambition d’y créer des maisons de la garde. La tournée du Dr Pavillon a achevé de montrer aux hôpitaux tout le potentiel de l’ambulatoire dans leur développement et leur financement. La SVM est la première à avoir concrétisé, avec l’appui du chef du DSAS dans le cadre de notre partenariat, un projet de maison de la garde à Vevey qui a très bien fonctionné, en lien avec la CTMG, avant d’être liquidée par le nouvel HRC qui s’était vu contraint d’offrir des locaux à côté du Samaritain.
En 2005, lors du changement de statuts des médecins hospitaliers, la SVM a fait reconnaître la garde médicale fournie par les médecins agréés dans les principales spécialités hospitalières, sous forme d’un financement pérenne de 200 francs par jour dans quatre secteurs, soit au minimum 560’000 francs par an, système toujours en vigueur mais de moins en moins compris par les nouveaux et nouvelles arrivé·es.
La SVM sauve son mandat in extremis
À la suite des nouvelles velléités de l’Etat de faire main basse sur la garde par une directive cantonale, nous sommes parvenus à la transformer in extremis en 2018 en une nouvelle convention de la garde octroyant à la SVM le mandat de la garde spécialisée mais plus de la garde de premier recours. Par contre, la SVM participe toujours à la gouvernance du tout à travers le copil DSAS-SVM.
Durant la longue période de transition, la SVM a continué d’assumer la gestion du logiciel de planification de la garde docbox, l’enrôlement des gardien·nes, le conseil et le support à ses membres, ainsi que la formation des mandataires. Cette activité qui s’est prolongée pendant près de trois ans a finalement été reconnue financièrement.
Seul le mandat de la garde spécialisée n’a pas été immédiatement financé. Les démarches en cours ont permis de normaliser progressivement la situation.
De même, les règlements et conventions spécialisées présentés par la SVM et ses groupements pour diverses spécialités ont pris du retard en raison des nombreux changements d’interlocutrices et d’interlocuteurs et d’une mauvaise compréhension. Toutefois, les exemples de la gastro-entérologie et de la pédopsychiatrie ont montré la voie à suivre.