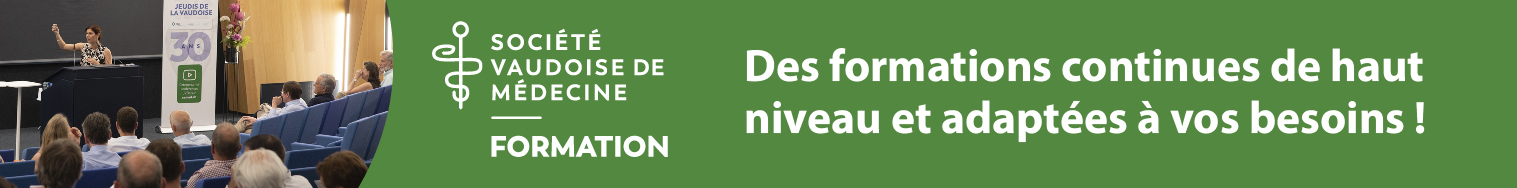1. Le temps des idées reçues et des chiffres
Foin d’idées reçues, vite des chiffres! Voici les données Scohpica, la Cohorte suisse des professionnel·les de santé et des proches aidant·es: 80% des médecins ont l’intention de rester dans la profession, l’intention la plus stable dans le domaine de la santé. Unisanté montre que seulement 13% des jeunes généralistes travaillent à 100%, mais que la moyenne du taux d’activité est de 70%. 70% ont une activité en dehors du cabinet, dans l’enseignement ou comme médecin-conseil.
«- Et c’était déjà mon cas. – Mais vous étiez toujours là. – Et pourtant beaucoup de mes patient·es se plaignaient. Maintenant votre doctoresse travaille dans un centre où il y aura toujours quelqu’un.» Aujourd’hui la moyenne du temps de travail du ou de la médecin suisse dans le secteur ambulatoire est de 8.6 demi-journées par semaine. C’est toute la société qui travaille moins: entre 1991 et 2023, les femmes travaillant à 100% sont passées de 50.9 à 42% et les hommes de 92 à 80%. Il y a des bienfaits dans le travail à temps partiel: médecins plus disponibles, moins stressé·es, plus productifs et productives dans la prévention et des patient·es satisfait·es. «Oui j’ai vu tout cela sur ChatGPT.» ChatGPT, un compendium d’idées reçues? Est-il possible d’aller plus loin?
2. Le temps vécu
Je n’ai jamais cru que je pourrais travailler à temps partiel. Comme médecin-assistant, je devais «tout mon temps à l’hôpital» et mon patron me répétait que le mot interne signifiait que j’étais dedans 24h/24. C’est mon surmoi professionnel. Dès que je me suis installé, j’ai pris mes jeudis de formation continue. Puis j’ai fait de l’enseignement et de la politique professionnelle, suis devenu médecin conseil du CMS, quand la consultation prenait 60 à 70% de mon temps. Mais la médecine représentait 100% de mon activité et c’est pour mes patient·es que je faisais tout cela. Je n’ai pris conscience du temps partiel que le jour où ma gérance m’a congédié de mon cabinet. Je payais mon loyer à 100%, ce qui représentait à mes yeux mon temps de travail. Je suis alors entré dans un centre médical où il a fallu calculer le taux d’occupation de mon bureau… et depuis, je travaille à 50% avec le sentiment d’être complètement médecin. Alors que reflètent les statistiques, le temps vécu ou le temps de contrat?
3. Le temps rempli
Allons voir les sociologues critiques. Hartmut Rosa décrit l’accélération du temps et son remplissage par plus d’activité. Le capitalisme aime le rendement et nos amis de santésuisse, adorateurs des courbes de Gauss et du «benchmarking» nous obligent à être rentables. Avec le temps, j’ai rempli les espaces morts et supprimé les moments de digestion clinique pour passer d’une histoire de vie à l’autre, sans égard pour ma propre métabolisation émotionnelle. La seule solution à cette aliénation est de passer de 45 à 35 heures d’activité accréditée par santésuisse. Pointons donc d’un doigt vengeur le coupable, pris qu’il est dans la spirale de la croissance à tout prix.
4. Le temps continu
Le temps partiel diminue la continuité personnalisée des soins. Les travaux de Saultz, qui datent de 20 ans, défendaient la continuité interpersonnelle contre celle du dossier. Aujourd’hui, le dossier et la carte informatiques sont devenus des mantras de l’idéologie gestionnaire, qui externalisent la relation dans les réseaux. Mes collègues sont conscient·es du problème. Bodenheimer propose des solutions: répartition des jours de travail sur la semaine, disponibilité quotidienne de l’équipe pour répondre aux patient·es avec possibilité d’atteindre le médecin, présence d’un·e nurse-practitioner, éducation du/de la patient·e, job sharing à deux docteurs dans un groupe. Mais le questionnement le plus intéressant est celui de Wyatt: le temps partiel est-il cause ou symptôme? Les statisticien·nes n’arrivent pas à expliquer l’augmentation du temps partiel par la féminisation de la profession, constamment invoquée. D’où l’hypothèse que notre monde favorise la discontinuité par la perpétuelle captation de notre attention et que le temps partiel en est la conséquence. On en revient à la sociologie. Arrêtons d’accuser les femmes…
5. Le temps court
Je termine par la dimension anthropologique. Pour avoir fréquenté beaucoup de jeunes médecins, j’ai été frappé par toutes celles et ceux qui invoquaient le syndrome de l’imposteur. On n’en parlait pas dans ma jeunesse, trop fières et fiers que l’on était d’avoir passé des examens et obtenu un diplôme. Maintenant que les diplômes font pâle figure face à l’évaluation continue des résultats, le sentiment d’insuffisance devant la tâche augmente. Ce sentiment est constitutif de la médecine: «L’art est long et le temps est court», disait Hippocrate. Mais ne laissons pas les gestionnaires du «grand capital» nous le rappeler et nous reprocher d’avoir besoin d’un temps de métabolisation. Défendons le temps partiel pour l’activité de TARMED et bientôt TARDOC, mais restons médecins à 100%.