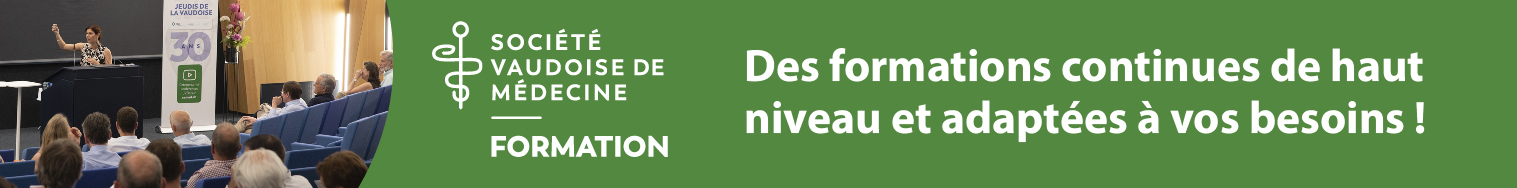Interview croisée
Soins intégrés: regards croisés d’un réseau et d’une médecin de famille
Coordonner, fluidifier, humaniser : derrière le terme de « soins intégrés » se dessine un nouveau modèle de collaboration entre médecins, prestataires de santé et hôpitaux. Dans cette interview croisée, la Dre Myriam Ingle, co-présidente de MFVaud, et le Dr Mikael de Rham, directeur de l’Ensemble hospitalier de la Côte (EHC), confrontent leurs visions et abordent sans détour les défis à relever pour améliorer concrètement le parcours des patient·es.
Propos recueillis par Aurélie Michielin
Qu’entendez-vous l’un·e et l’autre par « soins intégrés » ? Avez-vous un exemple de réussite ?

Dre Myriam Ingle, co-présidente de MFVaud
Dr Myriam Ingle : Pour moi, les soins intégrés, c’est la coordination entre le/la patient·e, son médecin de famille et tous les autres prestataires, avec pour objectif d’obtenir de l’efficience pour les patient·es, notamment en rationalisant les examens et les coûts. En Suisse romande, le réseau Delta, mis sur pied par des médecins qui ont négocié avec les assurances, en est un bon exemple : il permet de lier les intervenant·es de santé tout en proposant un produit d’assurance moins cher. Un autre modèle inspirant est le système danois centré sur le médecin de famille, impliquant l’État et les citoyen·nes et dans lequel l’hôpital intervient pour son expertise et ses plateaux techniques.
Mikael de Rham : Je partage ce point de vue. Le modèle hospitalo-centré et le cloisonnement actuel ont atteint leurs limites. Il faut passer d’une approche à l’acte à une approche coordonnée du parcours de santé, où l’ensemble des actrices et acteurs collaborent autour du/de la patient·e. À l’EHC, nous avons rapproché médecins de famille, spécialistes et médecins hospitaliers grâce notamment à un système d’information partagé. Un exemple de réussite? Il y en a plusieurs, dont celui des soins palliatifs, où le parcours du/de la patient·e est organisé entre différentes unités et professionnel·les (équipe mobile, unité hospitalière, pharmacie, EMS, etc.). Le fait d’être partie prenante du même parcours de soins permet d’anticiper les transitions et d’éviter les ruptures pour une sécurité accrue dans le parcours de soins.
Comment les médecins installé·es perçoivent-ils généralement ce type de réseau ?
MI: Il n’y a pas de réponse homogène. Ma génération voit bien que le système arrive à ses limites et est prête à s’engager dans ces changements. En fin de carrière, c’est plus compliqué. Une crainte majeure, c’est la perte d’indépendance : en cabinet, nous tenons à notre autonomie et craignons d’être enfermé·es dans une filière imposée. On peut aussi perdre la vision globale du parcours patient ou la relation privilégiée avec le/la patient·e si les réseaux sont mal conçus, comme certain·es l’ont ressenti avec le Réseau Viva du Jura. Mais souvent, ces peurs viennent d’un manque de communication ou d’une mauvaise conception du réseau.
Comment s’organise actuellement la coordination entre les professionnel·les de santé dans votre région ?

Dr Mikael de Rham, Directeur de l’Ensemble hospitalier de la Côte (EHC) (photo Maud Guye-Vuillème)
MDR : Dans une région comme la nôtre où les liens sont étroits, cette coordination s’appuie encore largement sur les relations interpersonnelles, le téléphone, le mail ou les échanges informels, Les points forts sont l’engagement et la proximité entre professionnel·les. Mais les limites sont réelles : absence d’outils numériques interopérables, lourdeurs administratives, sentiment d’isolement, manque de reconnaissance du temps de coordination et parfois des cultures professionnelles encore cloisonnées.
Qu’est-ce qui a motivé l’EHC à monter un réseau de soins intégrés et comment cela a-t-il été perçu par les médecins installés de votre région ?
MDR : Nous sommes partis du constat que les patient·es atteint·es de maladies chroniques, polymorbides ou âgé·es vivent des parcours fragmentés, coûteux humainement et financièrement. L’EHC, en tant qu’établissement de proximité, a une responsabilité populationnelle. La création du réseau répond donc à une logique de santé publique autant que de qualité des soins. Je souhaite confirmer que la construction du réseau EHC a pour objectif n° 1 de préserver le rôle de pivot du médecin généraliste dans le système de santé. Pourquoi intégrer un assureur maladie tel que CSS dans notre réseau ? Tout simplement pour financer le temps passé par les professionnel·les de santé à la coordination des soins, ce qui est la principale faiblesse de notre système tarifaire actuel. Nous n’avons pas signé de contrat d’exclusivité et nous sommes en discussion aujourd’hui avec d’autres assureurs. Les médecins installé·es ont, pour la plupart, perçu positivement cette initiative, car elle reconnaît leur rôle pivot. Certain·es ont exprimé des craintes initiales sur une possible perte d’autonomie, mais le travail de co-construction a permis de renforcer la confiance, qui est aujourd’hui très forte.
Y a-t-il, selon vous, un risque de créer un système à deux vitesses entre les professionnel·les « dans » le réseau et ceux « hors » du réseau ?
MDR : Oui, ce risque existe. Tout système qui valorise la participation à un réseau structuré peut, par contraste, marginaliser celles et ceux qui en sont exclu·es – volontairement ou faute d’avoir pu y accéder.
MI : Oui, bien sûr, mais quelle que soit la raison du réseau (modèle d’assurance ou réseau régional).
MDR : À l’EHC, nous avons conscience de cet enjeu et veillons à ce que l’accès au réseau reste ouvert, volontaire. Il ne s’agit pas de créer un “club” fermé, mais une dynamique collective, évolutive, avec des portes d’entrée multiples. C’est suivant ce principe que nous avons proposé à tous les médecins installé·es qui le souhaitent de rejoindre le réseau EHC via une simple agrégation, leur offrant un accès à notre système d’information.
La liberté thérapeutique est-elle menacée dans les réseaux de soins ?
MI : Dans toute institution, il existe des contraintes, mais dans la pratique libérale aussi. L’indépendance peut être très contraignante quand il s’agit d’affronter seul·e les différentes démarches administratives, financières, architecturales. C’est ce qui fait l’attrait de ces réseaux, tant que notre liberté thérapeutique reste garantie !
MDR : Les médecins du réseau EHC peuvent vous confirmer qu’ils et elles bénéficient d’une liberté thérapeutique complète. La réduction de l’autonomie des médecins découle plutôt des contraintes liées aux différents modèles d’assurance.
Quels bénéfices concrets observez-vous pour les patient·es et les professionnel·les ? Et à l’inverse, y a-t-il des effets inattendus ?
MDR : Pour les patient·es, on observe une diminution des hospitalisations évitables (indicateurs de réadmissions, recours aux urgences), une meilleure continuité du suivi (notamment grâce aux coordinatrices) et une satisfaction accrue. Nous cherchons également à démontrer qu’une prise en charge au sein du réseau réduit les coûts. Nous allons tout faire pour qu’à terme la population de la région puisse bénéficier de primes d’assurances les plus compétitives possibles. Pour les professionnel·les, l’accès en continu à l’ensemble des informations du dossier patient informatisé est un atout majeur, le sentiment d’isolement diminue, la charge administrative est mieux répartie. Mais paradoxalement, le temps dédié à la coordination est insuffisamment valorisé. Un effet inattendu est le risque de surcharge informationnelle ou de dilution des responsabilités si les rôles ne sont pas clairement définis.
Comment améliorer les relations ou la complémentarité entre réseau et médecins non intégrés ?
MDR : Nos attentes principales sont la reconnaissance mutuelle des rôles, l’ouverture au dialogue et la volonté partagée de centrer l’action sur le bénéfice pour les patient·es. Il ne s’agit pas d’imposer un modèle, mais de construire ensemble une complémentarité fluide entre réseau structuré et exercice libéral. Cela suppose, côté médecins non intégrés, une certaine curiosité et disponibilité à s’engager ponctuellement dans des démarches collectives, même sans adhésion formelle au réseau. Et cela implique aussi, de notre côté, de garantir la souplesse du dispositif, de respecter l’autonomie professionnelle et de ne pas enfermer la collaboration dans des logiques trop “protocolaires”.
Si vous aviez une mesure phare à proposer pour développer la coordination des soins dans votre région et renforcer l’implication des médecins de ville, quelle serait-elle ?
MI : Il faut des outils de partage de l’information, mais aussi de communication entre les professionnel·les impliqué·es dans la prise en charge des patient·es, et donc un dossier électronique du patient qui soit fonctionnel pour tout le monde. Il faudrait aussi pouvoir bénéficier d’un mécanisme de financement qui évite que le temps que l’on passe à la coordination ne péjore pas notre rémunération.
MDR : Tout à fait d’accord, il faut instaurer un financement dédié à la coordination interprofessionnelle, indépendant des actes médicaux, ce qu’offre notre partenariat inédit avec la CSS. Il est urgent de reconnaître le temps passé par les professionnel·les, dont les médecins de premier recours, à la concertation, à la planification conjointe et au suivi des parcours, y compris entre acteurs non médicaux.
Pensez-vous que les réseaux de soins intégrés deviendront incontournables dans les prochaines années ?
MI : Oui, ce n’est pas une tendance néfaste. Le réseau EHC et d’autres exemples internationaux démontrent que c’est une voie à suivre pour augmenter l’efficacité et l’économicité, tout en préservant la qualité des soins pour le bénéfice avant tout du ou de la patient·e.
MDR : Oui. Les accélérateurs sont clairs : épidémiologie, vieillissement démographique, pression financière, standards de qualité, révolution numérique, évolution des métiers et exigences démesurées des normes. Cela devient quasi impossible pour le médecin en cabinet de respecter toutes les normes qu’on lui impose. Le risque est que ce soient des prestataires ou des financeurs cotés en bourse qui construisent ces réseaux indépendamment des professionnel·les de santé.
Partagez votre opinion sur cet article !
Propos recueillis par Aurélie Michielin
Dans le même dossier
Ce qu'en pense
Les cantons veulent renforcer la collaboration en matière de planification hospitalière
Lukas EngelbergerCollaboration entre assureurs et hôpitaux
Vers un financement uniforme et une planification intercantonale
Adrien KayInterview croisée
Cliniques sous tension: défendre leur rôle dans le système vaudois
Propos recueillis par Aurélie MichielinInterview de Laurence Boland
« La nouvelle planification hospitalière a fait l’objet de consultations avec les partenaires »
Propos recueillis par Aurélie MichielinL'hôpital du futur