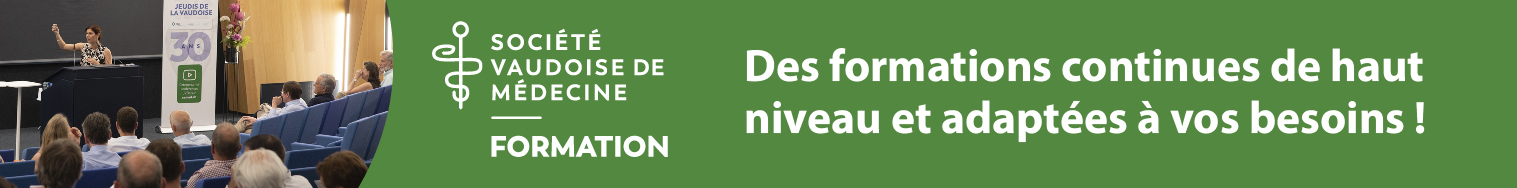Historiquement, le médecin hospitalier suisse bénéficiait d’une grande latitude dans l’organisation de son travail, dans ses choix cliniques et dans la définition de ses priorités. Aujourd’hui, cette autonomie est progressivement encadrée par des exigences de traçabilité, de performance et de conformité aux standards institutionnels. Cette évolution reflète une volonté légitime de modernisation du système, mais elle induit également une profonde redéfinition du rôle professionnel.
Un rôle aux multiples dimensions
Le médecin hospitalier contemporain est devenu un professionnel hybride. Sa fonction ne se limite plus à la pratique clinique et intègre aussi plusieurs responsabilités :
- Coordination d’équipes interprofessionnelles, conciliant logiques de soins, de gestion et de ressources humaines
- Gestion de la qualité, avec la mise en œuvre locale des standards nationaux ou internationaux
- Implication dans des projets d’innovation technologique ou organisationnelle, sans temps protégé ni financement dédié
- Encadrement pédagogique des médecins en formation, tout en assurant la continuité des soins.
- Cette multiplicité des rôles entraîne une fragmentation du temps médical et une surcharge mentale croissante. Le rapport 2019 de l’Association des médecins assistant·es et chef·fes de clinique suisses (VSAO-ASMAC) indique qu’un·e médecin-chef·fe travaille en moyenne 59,8 heures par semaine, tandis que les médecins-assistant·es disposent de moins de 10 % de leur temps pour la formation continue. Ces chiffres illustrent un déséquilibre structurel entre les attentes institutionnelles et les moyens réellement disponibles.
La promesse ambiguë du numérique et de la standardisation
Le virage numérique est souvent présenté comme une opportunité majeure pour améliorer la qualité des soins et la coordination entre les différent·es acteurs et actrices du système de santé. En Suisse, la « Stratégie cybersanté (eHealth) » a encouragé l’introduction du dossier électronique du patient (DEP), le recours à la télémédecine et à l’intelligence artificielle dans le quotidien clinique. Le baromètre suisse de la cybersanté (Swiss eHealth Barometer) 2025 révèle que 80 % des médecins hospitaliers voient dans la numérisation un levier d’amélioration, notamment en matière de partage d’informations. Pourtant, seul·es 56 % se disent satisfait·es de l’introduction du DEP, un taux en baisse continue depuis 2012.
Le malaise provient d’une asymétrie entre les outils déployés et les réalités cliniques. Beaucoup de praticien·nes dénoncent un surcroît de tâches administratives, une interopérabilité limitée et une perte de temps médical utile au contact des patient·es. De plus, la multiplication des protocoles, checklists et lignes directrices – bien qu’essentielle pour sécuriser les parcours – est vécue par certain·es comme une forme de judiciarisation implicite réduisant leur marge de manœuvre clinique.
Ce paradoxe est au cœur du malaise actuel : les technologies et standards, censés accompagner la décision médicale, tendent à la contraindre, voire à l’appauvrir.
Une gouvernance hospitalière à repenser
Parallèlement, la gouvernance hospitalière suisse s’est progressivement inspirée de modèles issus du secteur privé, misant sur des indicateurs de performance, des logiques de contractualisation et des principes d’efficience. Si ces approches ont permis de mieux piloter les établissements et d’optimiser certaines ressources, elles ont également engendré une prise de distance entre les organes décisionnels et le terrain clinique.
Dans de nombreux hôpitaux, les médecins ont vu leur capacité d’influence stratégique diminuer, au profit de structures managériales où la vision médicale est parfois marginalisée. Ce déplacement du pouvoir décisionnel crée un sentiment d’aliénation, particulièrement fort lorsqu’il s’agit de décisions touchant directement à l’organisation des soins : recrutement, équipements, structuration des services.
Or, l’implication du corps médical dans la gouvernance n’est pas un luxe – c’est une condition nécessaire pour garantir la pertinence et l’acceptabilité des réformes. De plus, les médecins hospitaliers sont souvent porteurs et porteuses de solutions concrètes pour améliorer les parcours, innover dans la pratique ou repenser les interfaces entre secteurs.
Pour un modèle hospitalier suisse durable et centré sur le sens
Le défi n’est pas de revenir à un modèle idéalisé du passé, où les médecins exerçaient seul·es et sans rendre de comptes. Il s’agit plutôt de construire un modèle équilibré, capable de répondre aux exigences contemporaines sans sacrifier le sens du métier. Cela implique plusieurs changements structurels :
- Instaurer une gouvernance partagée, intégrant systématiquement des représentant·es médicaux et médicales dans les décisions stratégiques afin de mieux articuler les choix managériaux avec les réalités cliniques
- Garantir du temps protégé pour les missions académiques (formation, encadrement, recherche), en incluant des indicateurs qualitatifs dans l’évaluation des performances médicales
- Former les médecins au leadership collaboratif, à la gestion de projet et à la communication interprofessionnelle afin de renforcer leur capacité à agir dans des contextes complexes
- Repenser la numérisation comme un appui et non un contrôle, en investissant dans des outils ergonomiques, sécurisés et centrés sur les besoins des soignant·es
- Valoriser les complémentarités professionnelles, en reconnaissant institutionnellement les rôles de chacun·e (corps infirmier, psychologues, personnel de l’administration), pour sortir d’une logique hiérarchique au profit d’un véritable travail d’équipe.
Le soin comme mission de sens
L’hôpital suisse de demain ne pourra pas faire l’économie d’un repositionnement du rôle médical. Ni technicien, ni simple exécutant, ni manager désincarné, le médecin hospitalier doit être reconnu comme un acteur central d’un système en évolution constante, collaboratif et durable. Le défi est à la fois éthique, organisationnel et politique.
Il est urgent de replacer la valeur du soin au cœur de l’organisation hospitalière, en conciliant performance, innovation, qualité de vie au travail et humanité. Cela suppose non seulement de repenser les conditions d’exercice, mais aussi de réinterroger ce que nous attendons, collectivement, d’un système de santé moderne.
Le temps est venu de restaurer un pacte de confiance entre institutions et médecins. Car soigner, encore aujourd’hui, reste une mission de sens. Et c’est ce sens qu’il faut préserver, pour construire l’hôpital suisse de demain.