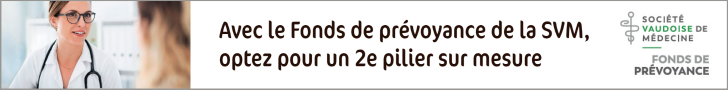La nécessité de consulter pour sa santé sexuelle témoigne déjà d’une vulnérabilité, car la sexualité demeure un sujet tabou dans le milieu médical, faute de formation adéquate. Bien qu’une orientation sexuelle non hétérosexuelle soit de mieux en mieux acceptée, les sexualités hors des normes de la monogamie exclusive (multipartenariat, sex-clubs, etc.) sont encore très stigmatisées. De fait, les personnes ayant été exposées à la moralisation développent une anticipation du jugement, ce qui peut constituer un frein ou entraîner un renoncement aux soins.
Une accumulation de barrières
Pour une grande partie de ces personnes, un vécu culturel différent, des barrières linguistiques, ainsi que des obstacles financiers et/ou administratifs peuvent s’ajouter et rendre l’accès impossible. On parle alors d’intersectionnalité, concept issu de l’afroféminisme apparu aux États-Unis, pour illustrer la situation de personnes subissant des discriminations croisées.
Par ailleurs, les personnes issues de groupes stigmatisés sont souvent atteintes dans leur santé mentale. En outre, comprendre les rouages du système d’assurance suisse représente une barrière importante, y compris pour des personnes sans difficultés financières et maîtrisant la langue. Ces démarches administratives éprouvantes engendrent un stress qui impacte la santé mentale, créant un cercle vicieux difficile à briser. J’ai souvent constaté que proposer un accompagnement administratif personnalisé sur place constitue un premier pas essentiel. Sans les ressources dédiées à disposition, j’ai moi-même accompagné proactivement ces personnes. Ce soutien permet de réduire le niveau de stress et facilite l’accès aux autres structures de soins.
Vers un modèle plus inclusif
Le modèle idéal repose sur des maisons médicales et des structures dédiées subventionnées, qui intègrent des équipes multidisciplinaires formées spécifiquement pour répondre aux besoins médicaux, sociaux et administratifs des populations vulnérables (migrant·es, LGBT+). Ce modèle permettrait une continuité des soins grâce à une approche personnalisée, sur site. Un chapitre dédié paraîtra prochainement à ce sujet dans le cadre d’un projet mené par l’Institut des humanités en médecine sur les Exclu·es de la santé, publié par la maison d’édition Médecine & Hygiène.