Politique professionnelle cantonale
Par Pierre-André Repond, secrétaire général de la SVM
Sommaire
Politique professionnelle cantonale
- Partenariat DSAS-SVM
- Commission paritaire cantonale
- Médecine hospitalière et planification
- Covid-19
- Garde médicale et Centrale téléphonique des médecins de garde
- Valeur du point TARMED (VPT)
- Clause du besoin
- Assistantes médicales
Politique professionnelle cantonale
Partenariat DSAS-SVM. En 2021, les réunions entre le DSAS et la SVM se sont poursuivies sous la présidence éclairée du Dr Jacques-André Haury, mais à un rythme moins soutenu compte tenu de la pandémie. La confiance n’est pas encore 100% présente avec la cheffe du DSAS et un nouveau souffle plus collaboratif reste à espérer pour la législature 2022-2027. Par exemple, l’extension décidée en 2020 de la convention de partenariat à deux nouveaux axes (analyse des coûts de la santé et médecine hospitalière) n’a malheureusement pas encore produit d’effets concrets, malgré les propositions de la SVM.
Dans le domaine hospitalier, la SVM souhaite toujours un accord-cadre qui puisse se transformer en une seule convention collective de force obligatoire (actuellement une CCT pour la Fédération des hôpitaux vaudois (FHV), une CCT pour l’Hôpital Riviera-Chablais (HRC) et une CCT pour l’Hôpital intercantonal de la Broye (HIB)) complétée ensuite par un règlement spécifique à chaque hôpital régional. Pour les médecins, il s’agirait d’un élément stabilisateur bénéfique pour l’attractivité de la médecine hospitalière vaudoise, qui souffre toujours d’un problème aigu de relève. Dans le domaine de l’analyse des données de facturation ambulatoires, la mise en place d’un suivi commun est devenue impérative pour réintroduire de la sérénité dans les discussions tarifaires, mais également pour que le Canton perçoive mieux la réalité du terrain.
Pour rappel, ce cadre conventionnel prévoit notamment des rencontres directes régulières entre le conseiller d’Etat en charge du DSAS et la SVM, autour de dorénavant 7 axes principaux de collaboration (données démographiques et épidémiologiques, relève et formation médicale, garde médicale, clause du besoin, prise en charge en réseau, analyse des coûts de la santé et médecine hospitalière).
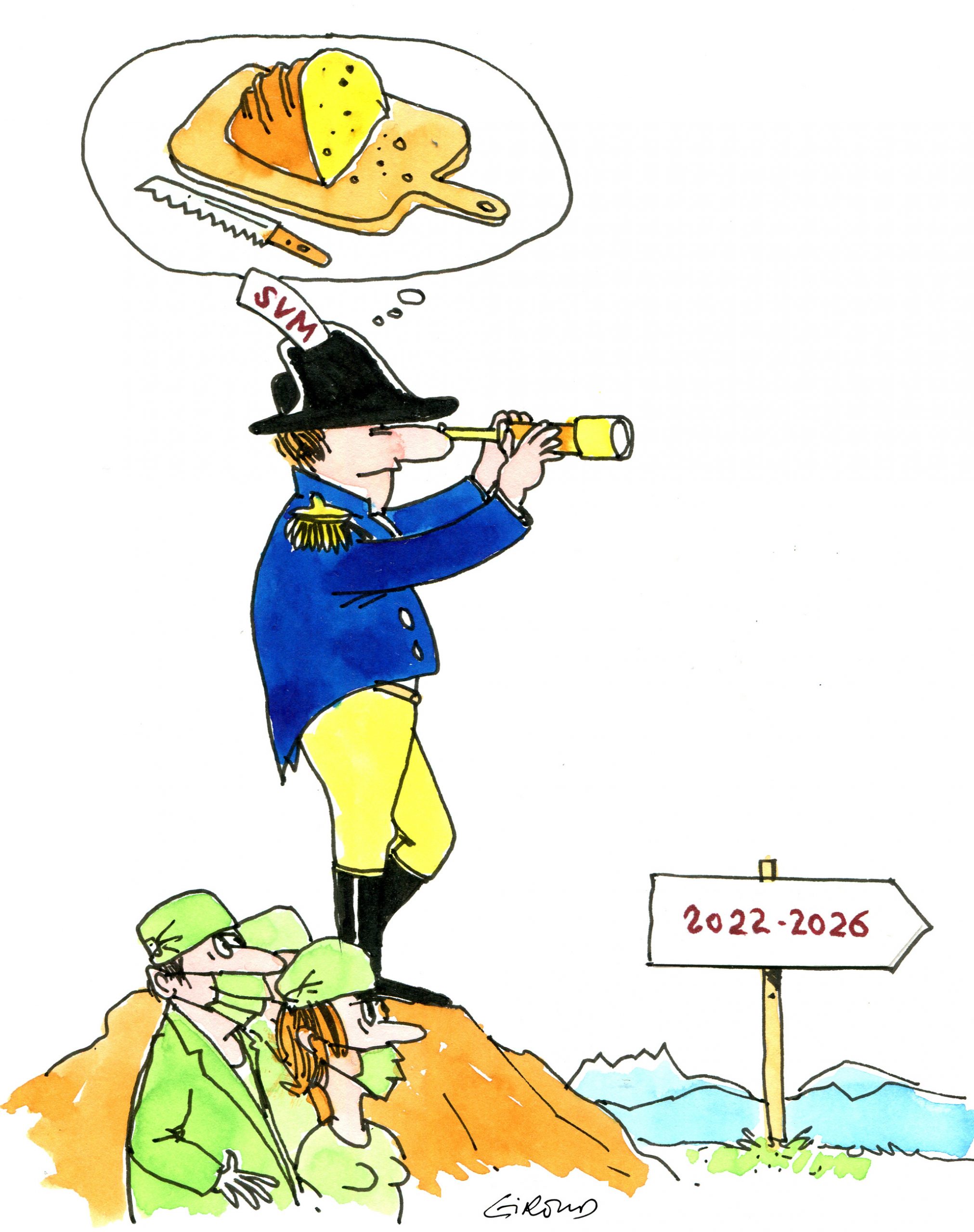
Lire à ce sujet : La coopération n’est pas une option (Pierre-André Repond, in Revue médicale suisse, février 2022)
Commission paritaire cantonale. En 2020, la commission paritaire cantonale vaudoise (CPC) a été convoquée à 18 reprises, sous la présidence neutre de Mme Sandra Rouleau, juge cantonal. Me Léonard Bruchez, de l’étude Rusconi & Associés, a assuré la fonction de greffier. Pour la SVM, y ont siégé les Drs Philippe Eggimann, Charles Steinhäuslin, Stéphane Lambert, Olivier Spinnler et David Knobel (3 à chaque fois).
Conformément à l’art. 19 de la convention tarifaire cantonale (CTC) en vigueur depuis 2008, la CPC est composée d’un nombre égal de représentants de la SVM et d’assureurs maladie. Cette commission a notamment pour rôle de tenter la conciliation en cas de litige entre médecins et assureurs maladie ayant adhéré à la CTC.
Les médecins de la commission paritaire se tiennent à disposition des membres concernés pour les orienter et les soutenir dans le cadre de ces procédures.
Dossiers cantonaux
Médecine hospitalière : conventions collectives de travail (CCT). A la suite entre autres des recommandations du Contrôle cantonal des finances (CCF) en 2019 sur l’organisation médicale des hôpitaux et cliniques reconnus d’intérêt public et la rémunération des médecins cadres, le chantier partenarial de relecture de la CCT SVM-FHV des médecins-chefs s’est poursuivi de manière intensive en 2021, avec également une pression liée à d’autres réformes connexes, notamment celle concernant les tarifs privés LCA (cf. supra) ou encore la planification hospitalière. Un dispositif de contrôle de l’application de la CCT a été adopté par les partenaires de la CCT FHV-SVM et sera mis en œuvre à partir de 2022. Ceci rendra inutile de légiférer en la matière. Une extension de ce dispositif à toutes les conventions collectives du même type est envisageable à terme.
Pour rappel, trois CCT pour les médecins-chefs et médecins-cadres cohabitent dorénavant dans le canton. Une nouvelle CCT intercantonale pour l’HIB a également été signée par la SVM une première fois en mars 2020 puis à nouveau en mars 2021, et l’on attendait toujours à la fin de l’année des informations sur la date de son entrée en vigueur. Quant à la CCT d’HRC, on relèvera le geste significatif des médecins qui sont entrés en matière sur une « contribution de solidarité » (baisse de rémunération), vu la santé financière encore précaire de l’établissement.

© Laurent Kaczor
Planification hospitalière. Conformément à l’obligation légale de réviser régulièrement sa planification hospitalière, le DSAS a mis en consultation en mai 2021 auprès de plusieurs partenaires (mais pas spontanément auprès de la SVM !) les critères de sélection devant servir à un futur appel d’offres du Conseil d’Etat pour les prestations hospitalières dans le domaine des soins somatiques aigus (y compris soins palliatifs et accouchements dans les maisons de naissance, mais hors psychiatrie et réadaptation). De cet appel d’offres découlera ensuite la nouvelle « liste hospitalière vaudoise », soit l’ensemble des hôpitaux et cliniques autorisés par le Canton à pratiquer à charge de l’AOS dans différentes spécialités médicales, et pour lesquels le Canton devra financer le 55% des prestations selon le système de forfaits DRG.
La prévisualisation ainsi donnée de la vision du DSAS de l’offre hospitalière vaudoise du futur a fait frémir de nombreux partenaires. En substance, il était annoncé une forte volonté de concentration de compétences médicales au CHUV au détriment des hôpitaux régionaux et des cliniques privées, tout comme le conditionnement de l’obtention de mandats de prestations à la salarisation de tous les médecins (fin du statut de médecin agréé) par les établissements publics et privés. Soit une impossibilité totale pour les cliniques privées de prétendre même maintenir les prestations actuelles délivrées dans le domaine AOS, et la fin annoncée ad minima de toutes les gardes spécialisées dans les hôpitaux régionaux, où interviennent des médecins indépendants agréés.
Devant le tollé suscité – même la discrète Chambre vaudoise de la santé (CDS) s’est fendue d’une lettre ouverte à la Cheffe du DSAS – l’entrée en vigueur initialement prévue début 2022 de la nouvelle planification hospitalière a été repoussée à janvier 2023. A relever qu’au surplus, le projet mis en consultation s’écartait de manière très significative du cadre légal fédéral (notamment du point de vue de l’égalité de traitement entre prestataires publics et privés) et de la jurisprudence (3 décisions récentes du Tribunal administratif fédéral concernant les quotas), ainsi que des critères (concept GPPH) déterminés par l’instance nationale compétente : la Conférence des directrices et directeurs cantonaux de la santé.
Enfin, selon le Dr Philippe Eggimann, président de la SVM, il y a lieu de noter que la convention globale de planification hospitalière vaudoise est échue depuis fin 2019, et que par conséquent, depuis 2020, le Canton finance des DRG (via le budget du DSAS) pour plusieurs centaines de millions de francs par an sans assise légale.
La SVM sera très attentive aux développements à venir dans ce dossier, tout en étant consciente que les médecins n’auront peut-être pas la qualité directe pour recourir, contrairement aux établissements hospitaliers.
En savoir plus :
- Rapport du président du GMH (Groupement des médecins hospitaliers)
- Rapport du président de l’AMC (Association des médecins-cadres du CHUV)
- Rapport du président du GMCP (Groupement des médecins travaillant en clinique privée)
Covid-19. Pendant toute l’année 2021, la SVM a d’abord continué d’informer ses membres (site web spécial régulièrement mis à jour, recensant l’information et la documentation ad hoc, newsletters relayant les consignes du médecin cantonal, etc.) concernant la pandémie de coronavirus. En juin, une campagne d’annonces dans la presse et en ligne fut également menée pour inciter la population à consulter son médecin en cas de question sur le Covid ou la vaccination. Il a par ailleurs fallu mener des négociations serrées pour obtenir que les garanties données de rémunération des médecins volontaires engagés dans le dispositif cantonal soient respectées.
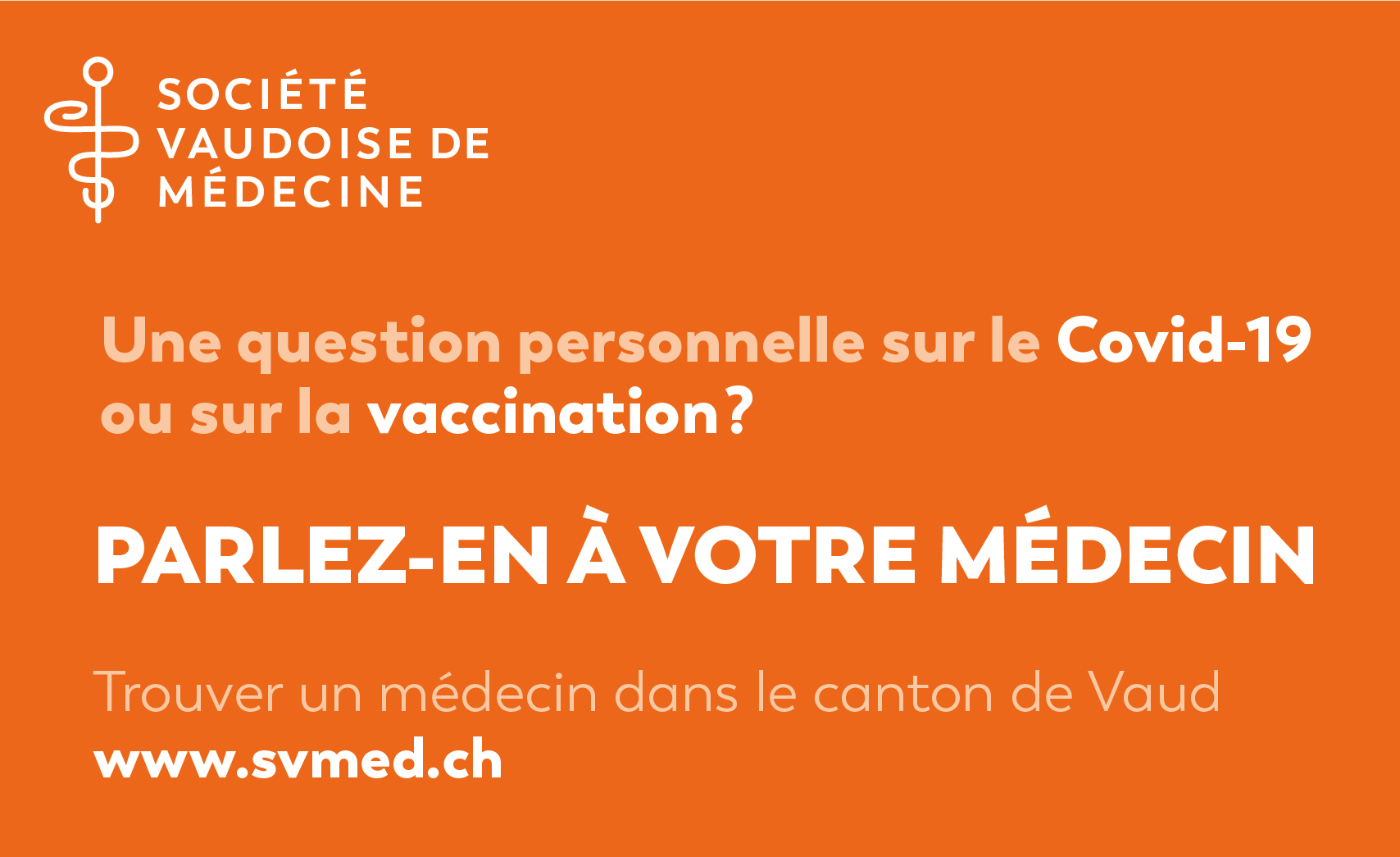
Sur le plan de la vaccination, après une phase pilote menée avec succès depuis janvier, la SVM a obtenu en mars l’accord du DSAS pour lancer à une plus large échelle la vaccination en cabinet. Suite à un appel aux membres volontaires qui rencontra un fort succès, environ 250 médecins installés obtinrent des doses pour vacciner 10’400 de leurs propres patients les plus à risques. Malheureusement, ce fut tout. Le DSAS ne souhaita pas associer les médecins installés à la suite de la campagne de vaccination, puis de rappel en fin d’année, privilégiant d’autres canaux. Ceci malgré la volonté de la SVM et l’engagement exemplaire du Groupe d’accompagnement et de coordination de la vaccination en cabinet (GRAC), formé avec Médecins de famille Vaud (MFV).
En décembre, la SVM et Médecins de famille Vaud s’associèrent encore à l’appel à la population des autorités politiques et sanitaires à recevoir une dose de rappel. Pour la suite de la gestion de la pandémie, la volonté de la SVM comme de la FMH est que les médecins soient pleinement associés aux éventuelles futures campagnes de vaccination et de rappel, comme ils le sont par exemple pour la grippe, mais aussi à la détection précoce de nouvelles vagues. C’est probablement aussi une des conditions à venir pour que le coronavirus passe d’une phase pandémique à une phase endémique. Ceci supposera toutefois une adaptation logistique et du conditionnement des doses en amont, de même que des conditions administratives et de facturation acceptables.
On l’espère, le moment viendra bientôt de faire le bilan de la gestion de la crise du coronavirus, exercice auquel le Conseil d’Etat s’est engagé. Il s’agira dans ce cadre aussi d’analyser la bonne mise en œuvre, avec les partenaires, du décret voté par le Grand Conseil sur « l’organisation du système de soins vaudois pendant la phase de lutte contre le coronavirus », qui devrait logiquement prendre fin en 2022.
Garde médicale et Centrale téléphonique des médecins de garde. Sous la pleine conduite depuis 2020 non plus de la SVM mais de quatre Commissions régionales de la garde soutenues par des mandataires régionaux (dont le financement est assuré par l’Etat), l’évolution de la garde médicale de 1er recours s’est poursuivie avec des développements inégaux dans les régions, pour tenter de répondre à certains particularismes, mais avec une efficacité parfois différenciée. Dans tous les cas, il apparaît désormais de manière très claire que le modèle du médecin de garde de nuit doit évoluer et la SVM, signataire de la convention qui chapeaute la garde médicale, continuera à être attentive à ce que les intérêts légitimes des médecins et de la population soient pris en compte.

En ce qui concerne les gardes de spécialités dont la SVM a conservé le mandat d’organisation, l’effort s’est poursuivi pour œuvrer au développement d’un cadre juridique clair et sûr, conformément à la Loi sur la santé publique et à la convention de la garde (y compris concernant la rémunération des médecins gardiens, qui ont parfois dû attendre des mois pour être payés). Moins visibles mais tout aussi importantes, les gardes de spécialités permettent notamment de mettre à disposition des hôpitaux affiliés à la FHV des médecins spécialistes agréés, donc d’assurer par une capacité complète et permanente de haut niveau sur l’ensemble du territoire, leur indispensable mission de santé publique.
La SVM a également observé avec une certaine tristesse les crises successives touchant la Fondation Urgences Santé, qui outre le service 144, gère aussi la Centrale téléphonique des médecins de garde (CTMG), soit le numéro d’appel 0848 133 133. Depuis plusieurs années, la SVM essaie, mais sans succès, de faire évoluer cette importante porte d’entrée dans le système que constitue la CTMG, notamment en revendiquant sa médicalisation et sa modernisation, soit la mise en relation directe de l’appelant d’un médecin de garde, une régulation médicale et l’intégration de la télémédecine.
Valeur du point TARMED (VPT). Malgré une stabilisation de la part des coûts des cabinets médicaux à charge de l’AOS (23%) et surtout moins de 1,5% de hausse par année depuis 2017, le Canton a maintenu sa pression et ses exigences, bien plus que dans d’autres secteurs placés sous sa maîtrise directe via le budget du DSAS. Ce climat défavorable a contraint la SVM à concéder une baisse d’un centime de la VPT pour l’année 2022 dans le cadre du renouvellement des conventions tarifaires avec les communautés d’achat HSK et CSS, même si une VPT conventionnelle inchangée a pu être préservée avec la troisième communauté d’achat, tarifsuisse.
Surtout la fin de l’année aura été marquée par l’annonce du DSAS, juste avant Noël, de faire fi du cadre légal fédéral pour tenter de forcer également une baisse de la VPT pour la convention SVM-tarifsuisse pourtant toujours en vigueur. Une piste heureusement non suivie par le Conseil d’Etat début 2022, au moment de la rédaction de ce rapport, suite également à une réaction publique vigoureuse des groupements de médecins particulièrement concernés.
Les premières hostilités en la matière ont été déclenchées en janvier déjà, lorsque le Canton prolongea sans base légale la convention tarifaire d’un an avec HSK, à la place d’édicter un tarif-cadre, solution imposée par la loi et la jurisprudence. Décision contre laquelle la SVM fit recours.
Dans le cadre d’un autre recours datant de 2019, le Tribunal administratif fédéral (TAF) donna ensuite raison à la SVM en avril sur l’obligation pour les autorités cantonales d’édicter un tarif-cadre, pour chaque convention tarifée approuvée. Lire le communiqué de la SVM à ce sujet. A relever que cette décision n’était toujours pas appliquée en fin d’année…
Puis quelques semaines plus tard, la publication d’un rapport du Conseil d’Etat à un postulat du député Riesen, annonça clairement la volonté politique du gouvernement vaudois de faire baisser la VPT de 4% de manière autoritaire au besoin, sans réelle prise en compte de la LAMal, du cadre conventionnel et de la jurisprudence, mais surtout de la réalité économique du terrain. L’Assemblée des Délégués de la SVM (AD) du mois de juin 2021 vota dans la foulée une résolution à l’attention du Conseil d’Etat lui demandant notamment de « cesser de contourner le cadre légal fédéral à propos de la valeur cantonale du point TARMED », le rapport publié équivalant à une claire tentative d’obtenir une caution du Grand Conseil à une action non-conforme à la LAMal.
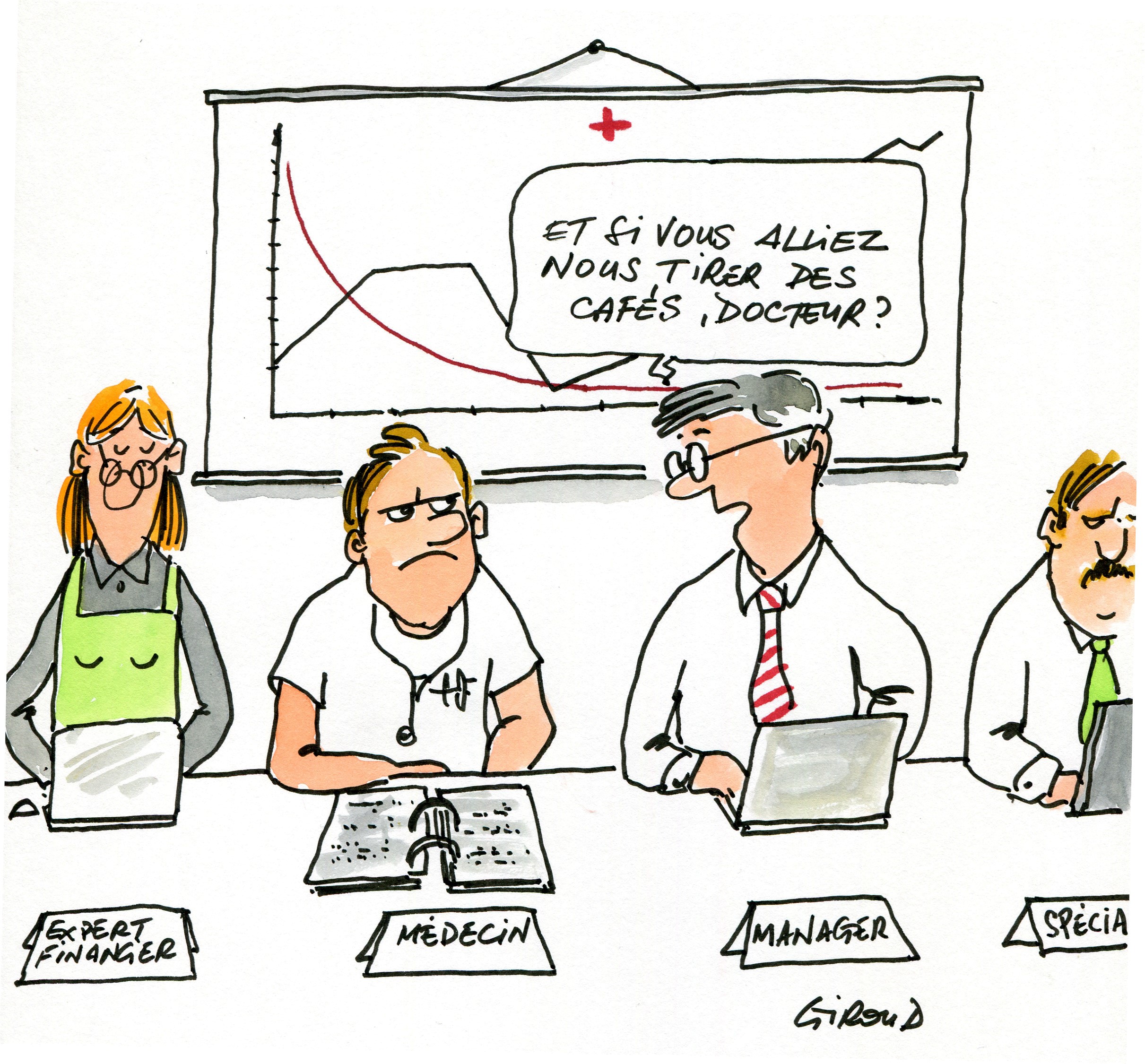
Dans le cadre des travaux de la Commission thématique de la santé publique (CTSAP) chargés de préaviser sur la réponse à ce postulat, la SVM put enfin présenter son analyse de la situation et ses arguments. L’épilogue au Grand Conseil est désormais attendu pour 2022, après les élections cantonales.
Clause du besoin. Le 1er juillet 2021 est entrée en vigueur une nouvelle réglementation fédérale concernant l’admission des fournisseurs de prestations à facturer à l’Assurance obligatoire des soins (AOS), dite « clause du besoin ». Notamment, quatre ordonnances fédérales révisées, qui vont au-delà de l’esprit du législateur, donnent désormais les pleins pouvoirs aux cantons pour préciser les possibilités d’installation de nouveaux médecins sur leur territoire (cf. CMV n°3/2021, p. 20).
Si le futur régime vaudois n’est pas encore défini (les cantons ont 2 ans pour le faire), la SVM craint toutefois une « clause du besoin » plus sévère qu’ailleurs, notamment en lien avec le statut d’employeur du Canton. La SVM plaide dans ce dossier pour que la reprise de cabinets existants et l’installation de médecins de premier recours soient exemptées de toute limitation, comme dans un passé récent et que tous les médecins remplissant actuellement les conditions voient leurs droits acquis sauvegardés. Elle demande également que son préavis (comme l’a décidé la Cour constitutionnelle) et celui de ses groupements régionaux et de spécialités continuent à être pris en considération lors de chaque demande, afin de favoriser des installations au bon endroit et au bon moment.

© Laurent Kaczor
Assistantes médicales. Après la revalorisation du salaire minimum mensuel recommandé dès 2021 à 4200 CHF pour les assistantes médicales des cabinets médicaux, le comité de la SVM a accepté pour 2022 une indexation des salaires de 1,2% pour tenir compte de l’augmentation du coût de la vie (selon l’IPC, indice national des prix à la consommation). Il s’agit d’un geste fort pour la reconnaissance de la profession d’assistante médicale, partenaire indispensable des médecins dans la prise en charge des patients, mais également d’une charge pérenne supplémentaire pour les cabinets dont il serait juste de tenir compte dans le cadre des débats autour de la VPT. Il faut aussi saluer la bonne collaboration actuelle avec la section vaudoise de l’ARAM (Association romande des assistantes médicales), y compris en ce qui concerne les enjeux dans le domaine de la formation professionnelle initiale et continue.
