J’ai lu dans le dernier numéro du Courrier du Médecin Vaudois le dossier consacré aux médecins face à la mort (CMV 4, 2021). Je félicite le comité de rédaction d’avoir publié ce dossier passionnant et présenté autant de multiples aspects du problème. Toutefois il en est un qui n’a pas été abordé, c’est celui du regard envers la mort au cours du temps et selon les lieux et les cultures. Permettez-moi donc d’y ajouter ma contribution.
En préambule, je rappellerai que depuis 30 ans, j’ai effectué de nombreuses missions en Afrique, dans le cadre de la collaboration entre le Service de Chirurgie Pédiatrique du CHUV et Terre des Hommes. Ainsi, nous allons soigner des patients – des enfants en ce qui me concerne – et enseigner notre médecine, dans l’idée généreuse d’apporter une guérison bienfaisante selon notre système de référence culturelle, sans nous enquérir auparavant de la représentation de la maladie, des traumatismes, des malformations et de la mort des populations que nous pensons aider. Une bonne compréhension du regard que les autres sociétés portent sur la maladie et la mort est indispensable pour aider les patients et éviter des erreurs. C’est ainsi que je me suis intéressé à l’anthropologie médicale. Je vous propose d’évoquer ici les différents regards que nos sociétés portent sur la mort. Pour ceux qui s’intéresseraient aux autres aspects étudiés, à savoir les regards croisés sur la maladie, les malformations, les accidents en Europe et en Afrique, ou qui chercheraient les références bibliographiques, je les renvoie au texte initial [1].
Evolution du regard sur la mort en Occident
Le regard des sociétés a évolué dans le temps au cours de siècles. Les notions de maladie avec une explication physiopathologique sont des concepts récents qui ont ouvert la porte à des traitements rationnels.
La médecine occidentale a d’abord été une médecine de la fatalité. Dès la civilisation mésopotamienne, malformations et déficiences mentales sont liées à la faute et au péché. L’idée du mal ne peut être dissociée des rapports entre les dieux et les hommes. Chez les égyptiens ces maux ne sont pas toujours considérés comme un châtiment, mais comme l’expression de la divinité. Certaines anomalies bénéficiaient d’une promotion sacrée: un culte fut rendu à un anencéphale à Heliopolis (Plutarque).
Sparte pratique un eugénisme qui n’accepte que des guerriers sains et élimine les faibles. « …Quand un enfant lui naissait, le père n’était pas maître de l’élever : il le prenait et le portait dans un lieu appelé Lesché, où siégeaient les plus anciens de la tribu. Ils examinaient le nouveau-né. S’il était bien conformé et robuste, ils ordonnaient de l’élever. Si, au contraire, il était mal venu et difforme, ils l’envoyaient en un lieu appelé les Apothétes qui était un précipice au pied du Taygète. Ils jugeaient, en effet, qu’il valait mieux pour lui-même et pour l’Etat ne pas le laisser vivre, du moment qu’il était mal doué dès sa naissance pour la santé et pour la force ».
Les romains étaient expéditifs: on éliminait les nouveau-nés malformés: « Nous assommons les chiens enragés, nous tuons les taureaux farouches, nous égorgeons les brebis malades de peur qu’elles n’infectent le troupeau, nous étouffons les nouveau-nés mal constitués; même les enfants s’ils sont débiles ou anormaux, nous les noyons. Ce n’est pas de la colère mais de la raison qui nous invite à séparer des parties saines celles peuvent les corrompre » (Sénèque). Mais porter les enfants hors de la ville, ou les noyer ne signifie pas les exécuter mais les remettre aux dieux. Stobée, qui rédige vers 450/500 un recueil des opinions des auteurs anciens grecs et romains, écrit que, dans l’ensemble, on ne considérait pas l’exposition, l’infanticide ou la mutilation des enfants (difformes ou pas) comme des crimes.
Cette attitude change avec Origène (185-253) qui ordonne aux chrétiens : « Vous n’immolerez pas le nouveau-né, car tout être formé dans le sein de sa mère a reçu de Dieu une âme et sera vengé si on le fait périr injustement ». Dans un édit de 318, Constantin (280-337) applique à l’infanticide la même peine que pour le parricide. Cette mesure est confirmée à plusieurs reprises par ses successeurs, en particulier par Justinien (483-565); mais en fait, la législation justinienne reste lettre morte en France pendant de longs siècles.
La notion de médecine destinée à préserver la santé et la vie a été développée par les arabes abassides qui nous ont transmis le savoir grec: Harûn-al-Râchid (786-809) construisait à Bagdad au début du IXe siècle, l’hôpital Bimaristan et en confiait la gestion à Al-Razi (Rhazès) puis à Ibn-Sinna (Avicenne). La santé était considérée comme un tout, qui incluait le religieux, le culturel, l’hygiène de vie, la nourriture, la pharmacopée et des soins médicaux et chirurgicaux. Il faut reconnaitre qu’à cette époque, la médecine arabe représentait le sommet de ce qu’il était possible d’atteindre dans ce domaine. Pour un malade ou un blessé, les chances de survie étaient beaucoup plus grandes à Bagdad ou à Damas qu’à Paris ou à Rome
Le moyen âge connaît des conditions de vie précaires, une mortalité infantile importante, des épidémies catastrophiques (peste, choléra), de sorte que la vie est brève et que l’atteinte d’un âge avancé est une exception. « Le christianisme au moyen-âge, fortement marqué par l’empreinte de l’Apocalypse, devient une religion non point tant de joie et d’amour fraternel, que de culpabilité et de crainte prosternée ».
Il faut attendre Jean Fernel (1497-1558) pour distinguer l’affection « maladie » de l’affection « symptôme » et que la maladie commence à ne plus être considérée comme une expression divine. Le premier, il rompt avec 13 siècles de tradition héritée de Galien et définit la maladie comme une « affection » du corps vivant (morbus est affectus contra naturam corpori insidens). Elle devient l’expression d’un désordre du corps que le médecin tente de réparer. La mort devient ainsi quelque chose contre quoi on pourrait agir.
Référentiel culturel en Afrique sub-saharienne
Les médecines traditionnelles africaines reposent sur des systèmes de pensées parfaitement logiques, mais elles restent irrationnelles pour nous, parce qu’elles expliquent une maladie par une vision magico-religieuse. Lorsque cette médecine fait appel à des remèdes empiriques, elle ne se soucie pas d’expliquer la maladie. La compréhension de la pensée magique est donc indispensable pour aborder les médecines traditionnelles. Il nous faut donc connaître les mythes et les cosmogonies qui les gouvernent.
Les mythologies africaines sont nombreuses, complexes et variées et ne peuvent faire l’objet d’un panorama exhaustif. En l’absence d’écriture, la transmission des mythes est une tradition orale, qui de ce fait nous est mal connue. Heureusement il existe quelques transcriptions écrites des mythes fondateurs de certaines sociétés africaines. On connaît particulièrement bien celle des Dogon par le récit qu’en a fait Marcel Griaule dans « Dieu d’eau »: Après une quinzaine d’années passées chez les Dogons, Marcel Griaule reçoit un jour d’octobre 1946 la visite du messager du sage Ogotemmêli, « chasseur devenu aveugle par accident, qui devait à son infirmité d’avoir pu longuement et soigneusement s’instruire ». Celui-ci l’invite à venir le voir et lui révèle « ce qu’il a toujours cherché à savoir » au cours de 33 entretiens rassemblés sous le titre « Dieu d’eau » (1948). Ces entretiens initiatiques et la connaissance qu’ils nous apportent « bouleversera de fond en comble les idées reçues concernant la mentalité noire comme la mentalité primitive en général ». Pour Griaule, les traces du Zodiaque méditerranéen retrouvées chez les Dogons sont la preuve que cette métaphysique fondamentale a traversé les millénaires et a trouvé un lieu privilégié de conservation en Afrique sub-saharienne, en particulier au pays Dogon.
La vie quotidienne des peuples africains est imprégnée de cette vie spirituelle, peuplée de dieux, de génies et d’esprits. Pour les Dogons ainsi que pour les Malinkés et les Bambaras, la mythologie imprègne avec tant de force les différents aspects de la vie humaine qu’il existe une correspondance entre elle et les différentes parties de l’anatomie humaine ou le système astronomique. Le rapport au monde invisible s’exprime tout au long de l’existence des peuples africains au travers de manifestations organisées pour célébrer la correspondance entre monde terrestre et monde spirituel. Ces cultes, auxquels sont liés divers objets tels les masques et les statuettes, se réalisent sous des formes que l’on retrouve de façon constante chez les différents peuples : sacrifices sanglants ou non, offrandes, récitations, chants, musiques et danses célèbrent des rites liés entre autres à des questions de purification, d’initiation, de commémoration ou de deuil. Les dieux et les forces invisibles qui gouvernent le monde habitent le quotidien de la spiritualité africaine dans certaines régions où pourtant le christianisme et l’islam ont pris une large place au fil des siècles. Cependant les croyances ancestrales jouent toujours un rôle prépondérant. Comme me le disait au Togo un père chrétien de la congrégation Fatebenefratelli qui connait très bien ses ouailles, lui-même chirurgien et missionnaire depuis des décennies au Bénin et au Togo, « ils sont bons chrétiens de jour et animistes la nuit ».
Regards croisés sur la mort
Le regard que nous portons sur la mort est déterminant dans notre attitude envers elle.
Pour les anthropologues, il n’y a pas de société sans rites et il n’y a pas de rapports sociaux sans actes symboliques. Les rites funéraires sont un lien très fort entre les vivants et les morts et entre les vivants entre eux. Ils nous apprennent beaucoup sur la vision de la mort.
Pour Jean-François Noble, fondateur de stages en éducation pastorale clinique dès 1990, la caractéristique de notre société occidentale moderne est « l’analphabétisme des émotions » devant la mort. Notre société escamote la mort alors que de tous temps, toutes les civilisations ont construit des rites pour la gérer.
Philippe Ariès, historien, décrit très bien l’évolution de notre société devant la mort: durant les premiers millénaires avant et après JC, la mort est publique. La mort est vécue comme l’ultime repos auquel chacun a droit au terme de son existence. La mort fait partie de la vie sociale. Il n’est pas possible de mourir seul. La notion de « service funèbre dans l’intimité » que nous connaissons aujourd’hui est un non-sens. Vers l’an mille apparaît la notion du « jugement dernier ». La mort devient dramatique parce qu’au-delà d’elle se joue la suite de notre destin. On s’en remet à l’église pour nous prévenir d’un futur funeste dans l’au-delà par des pratiques expiatoires. Avec le XVIIIe puis le XIXe siècle, apparait la notion de mort pathétique. La mort devient la souffrance des survivants. C’est de cette époque que datent les rituels modernes. On entoure la mort d’un rituel ostentatoire: décorum de services funèbres, catafalque noir et argent, exposition du cercueil sur une estrade, vêtement noirs de la famille, monuments funéraires. Aujourd’hui la mort est escamotée. Elle n’est pas une fin préparée, mais une échéance que l’on tente d’ignorer et de repousser le plus loin possible par la magie de la science médicale. C’est bien de magie qu’il s’agit. Aujourd’hui la mort doit nous cueillir subitement, discrètement, en bonne santé. Ses suites doivent être aussi discrètes que possible: le cercueil est fermé et on voit peu le mort, le corbillard n’est plus suivi et son voyage est perdu dans l’anonymat de la circulation, les corps sont incinérés. Il n’y a plus de célébration d’un repas pris ensemble. On en vient même à maquiller les corps (USA) pour qu’ils n’aient pas l’air de cadavres. Ces comportements sont des conduites de défense et un déni de la mort. Bref, comme l’écrivait avec beaucoup de justesse Georges Brassens, « mais où sont les funérailles d’antan ». A l’hôpital la situation est encore plus nette: le patient n’est pas là pour mourir mais pour guérir. Or les statistiques montrent le contraire, puisque de plus en plus de personnes décèdent à l’hôpital.
Les sociétés africaines ont gardé les traditions des rites de la mort. Les rites chrétiens sont toujours bien présents et l’accompagnement du défunt et de sa famille est l’occasion de manifestation de cohésion sociale. Dans la pensée animiste le passage sur terre n’est que momentané et l’on reviendra plus tard sous une autre forme. Le « double » après la mort va vivre « ailleurs » : sous l’eau, gardé par un génie, mais seulement en attendant de pouvoir rejoindre le groupe en occupant le corps d’un nouveau-né. Ils admettent également l’existence d’un second principe immatériel : l’âme vitale, recueillie après la mort par des rites spécifiques dans l’autel des ancêtres. Comme l’écrit Birago Diop (Sénégal) dans son très beau poème « Le souffle des ancêtres » « Ceux qui sont morts ne sont pas morts… les morts ne sont pas sous la terre, ils sont dans l’ombre qui frémit, ils sont dans l’eau qui coule, Ils sont dans l’eau qui dort, Ils sont dans la case, ils sont dans la foule. Les morts ne sont pas morts. » C’est pourquoi le culte des ancêtres est si présent tant dans l’aspect animiste (omni-présence des « assins » dans les habitations) que chrétien, et une famille peut se ruiner pour un bel enterrement ou pour payer une belle tombe.
Quand un homme meurt, dans un accident de la circulation par exemple, un prêtre vaudou procède à une cérémonie pour «rassembler» l’âme éparse du défunt et lui montrer la voie vers Koutomé, le royaume des Morts. Sinon la victime ne trouverait pas la paix et viendrait la nuit hanter les lieux où elle a vécu en poussant d’horribles cris. Et il y aurait toujours des accidents là où elle est morte. Le terme Egun est employé par les Yorubas du Nigeria et du Bénin pour évoquer les ancêtres. Pour les Yorubas, les esprits qui habitent Kutome, l’autre monde, doivent être régulièrement rappelés sur terre pour rétablir l’équilibre cosmique menacé par les transgressions humaines. Ce rituel du retour se déroule chaque année entre juin et novembre et dure un mois. Les esprits dotés d’un immense savoir et d’une très grande puissance, sont invoqués pour aider et conseiller les vivants.
Il me faut toutefois modérer mes propos car si la description que j’ai faite du regard sur la maladie et la mort est telle que vécue dans les petites villes et les zones rurale, cela n’est plus vrai dans les grandes villes. Depuis plus de 30 ans que je participe à des missions en Afrique sub-équatoriale, j’ai pu constater une évolution. Le regard sur la maladie et la mort s’occidentalise, au même rythme que s’implantent les fast-food dans les grandes villes.
Ainsi dans le monde occidental la mort est ressentie comme un échec de la médecine, tandis qu’il n’en est rien dans la société africaine ou elle a le double rôle d’achèvement d’une vie qui permettra d’accéder au paradis et fait partie du cycle de la nature, puisqu’on reviendra. Il ne s’agit donc pas d’un échec de la médecine, mais des cycles de la vie et de la mort.
Il s’agit d’un problème très complexe de la représentation du temps, que nous ne pouvons qu’évoquer brièvement ici. La nature et la biologie nous offrent une représentation cyclique du temps, parfaitement intégrée dans les civilisations antiques et les cultures africaines qui en ont hérité (stoïciens, palingénésie = génèse de nouveau ou régénération). Le dieu Dan (le serpent qui se mord la queue) sur les bas-reliefs d’Abomey (Bénin) en est l’illustration. La mort n’est qu’une phase d’un cycle. Les civilisations monothéistes ont imaginé une représentation linéaire du temps : au jour J, à l’heure H, il s’est passé quelque chose (Les tables de la loi, la Nativité, l’Hégire) et plus rien ne sera jamais comme avant. Pour les religions monothéistes, le temps circulaire faisait courir le risque qu’un autre messie puisse venir. La mort est donc une fin en soi. Contrairement aux civilisations que n’ont connu que la représentation cyclique du temps, les religions monothéistes ont dû jongler pour combiner deux modes incompatibles de représentation du temps. Ceci nous a valu quelques représentations magnifiques de ces deux concepts, comme le tympan de Saint Lazare d’Autun, celui d’Aulnay ou de Vézelay, ou les montres molles de Salvator Dali (Le temps qui s’écoule est une illusion), pour n’en citer que deux.
Conclusions
Dans ces remarques, je me suis livré à une réflexion sur les représentations de la mort dans les cultures que j’ai essayé de comprendre lorsque je me rendais en Afrique sub-saharienne, par des lectures et de très nombreux entretiens. J’ignore tout des autres. Nul doute qu’un tel exercice peut être fait et doit être fait, lorsque nous partons en voyage confronter notre culture médicale à celle des populations que nous visitons. Avec les migrations, il n’est plus nécessaire de voyager pour être confronté aujourd’hui chez nous, à d’autres modes de cultures et de pensée. Il me semble donc souhaitable de se pencher avec humilité sur les croyances et les cultures des autres, car leurs attentes ne sont pas forcément les nôtres.
Prof. Olivier Reinberg
Chirurgien Pédiatre FMH EBPS
Références :
[1] Le texte complet et la bibliographie « Des Dieux et des Hommes : approches de la maladie en Afrique et en Europe » peuvent être consultés sur ce lien.
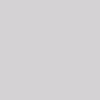 Hommage au Dr Sylvain Juilland03.12.25
Hommage au Dr Sylvain Juilland03.12.25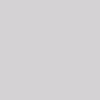 Lettre ouverte à toutes les femmes — et à leurs médecins, sur le silence entourant l’annonce historique de la FDA concernant l’hormonothérapie de la ménopause28.11.25
Lettre ouverte à toutes les femmes — et à leurs médecins, sur le silence entourant l’annonce historique de la FDA concernant l’hormonothérapie de la ménopause28.11.25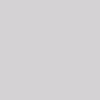 La médecine en clinique privée DIMINUE les coûts de la santé12.11.25
La médecine en clinique privée DIMINUE les coûts de la santé12.11.25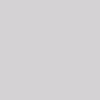 Du bon usage de l’empathie26.10.25
Du bon usage de l’empathie26.10.25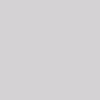 Médaille d’argent mondiale, est-ce vraiment notre faute ?12.10.25
Médaille d’argent mondiale, est-ce vraiment notre faute ?12.10.25
1 commentaire
Cyril